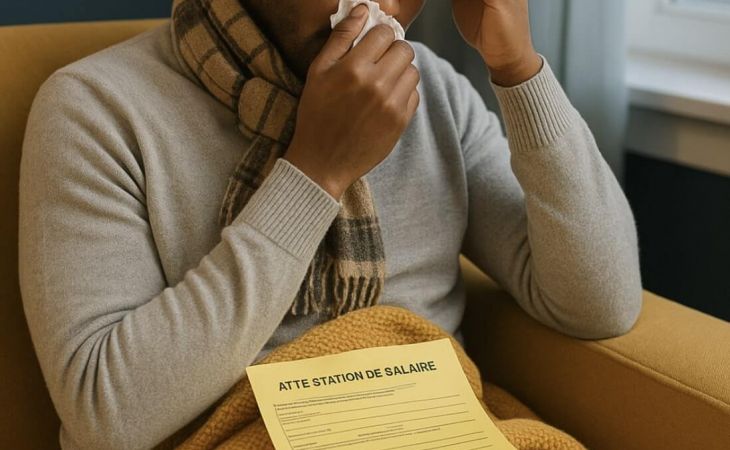Arrêt maladie : rupture d’indemnisation entre deux arrêts
L’essentiel à retenir
-
Depuis le 1er septembre 2024, toute période non couverte par une prescription entre deux arrêts entraîne une perte d’indemnisation, même en cas de prolongation.
-
Ce nouveau cadre introduit une dissociation entre les droits acquis et les indemnités perçues, induisant des effets de seuil redoutables pour les assurés.
-
La désynchronisation entre prescription médicale, signalement DSN et versement des IJ fragilise les protections traditionnellement attachées à l'arrêt maladie.
-
Cette réforme interroge la compatibilité du régime actuel avec les principes fondamentaux du droit social, notamment le principe de continuité des droits.
Un changement doctrinal lourd de conséquences pratiques
La suppression de la tolérance sur les jours intercalaires
Avant septembre 2024, la CNAM admettait l’indemnisation des jours “intercalaires” (généralement samedi et dimanche) entre un arrêt et sa prolongation, même sans couverture explicite sur ces journées, sous certaines conditions. Cette tolérance, bien que non codifiée, s'était consolidée comme une pratique constante, intégrée dans les processus RH et les paramétrages DSN.
La réforme opérée par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), officialisée fin mars 2025, met un terme à cette approche en posant une règle claire : en l'absence de prescription couvrant sans discontinuité la période entre deux arrêts, aucune indemnité journalière maladie (IJSS) ne sera versée, y compris si le second arrêt est prescrit comme “prolongation”.
Une logique de carence réintroduite de manière systémique
Trois cas se distinguent :
-
Interruption de 1 à 2 jours et arrêt suivant coché comme “initial” : nouveau délai de carence de 3 jours et nécessité d’une nouvelle attestation de salaire.
-
Interruption de 1 à 2 jours avec prescription “prolongation” : pas de nouveau délai de carence, mais pas d’indemnisation des jours intercalaires non prescrits.
-
Interruption ≥ 3 jours : traitement en arrêt initial, quel que soit le libellé du formulaire ; nouveau délai de carence et nouvelle attestation nécessaires.
Ces évolutions complexifient le traitement administratif et augmentent le risque de désynchronisation entre les arrêts médicaux, la DSN et le calcul des droits.
Une désynchronisation dommageable entre droits sociaux et temporalité administrative
Des délais de carence qui emportent des effets rétroactifs sur le revenu
Le cœur du problème réside dans la dissociation entre :
-
la continuité clinique de l’état de santé du salarié, souvent validée par le médecin via une mention “prolongation” ;
-
et la discontinuité administrative de la couverture, due à l’absence de prescription sur une période interstitielle, même brève.
La conséquence est immédiate : le salarié se retrouve sans ressource pendant un ou plusieurs jours, malgré une incapacité médicale continue. Cette perte de revenu, même temporaire, est de nature à rompre l’équilibre fondamental du régime des arrêts maladie.
Une mise en difficulté des RH et gestionnaires de paie
En DSN, les arrêts cochés “prolongation” et transmis sans interruption n’appelaient jusqu’à présent aucun nouveau signalement. Or, désormais, toute interruption de plus de 2 jours impose une requalification de l’arrêt (même s’il est médicalement une prolongation) et un nouveau signalement d’arrêt.
Le traitement différencié, fondé sur un critère purement calendaire, crée un risque d’erreur élevé, particulièrement dans les entreprises où les outils de gestion de paie sont semi-automatisés ou où les flux médicaux sont traités en décalé.
Une atteinte indirecte au principe de continuité des droits sociaux
La fragilisation du droit à indemnisation maladie
Le principe de continuité des droits en matière de protection sociale n’est pas expressément consacré par un texte unique, mais découle de plusieurs sources :
-
le préambule de la Constitution de 1946 (alinéas 10 et 11), qui consacre le droit à la santé et à la sécurité matérielle ;
-
l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, qui fonde l’indemnisation sur la reconnaissance médicale de l’incapacité temporaire.
En introduisant une rupture indemnisatoire fondée non pas sur l’état de santé réel mais sur une formalité de prescription continue, la réforme opère un glissement vers une logique purement formelle, peu compatible avec ces garanties.
Un traitement différencié sans fondement médical
Le caractère automatique du nouveau délai de carence, combiné à l’absence d’IJ sur des jours non prescrits mais immédiatement suivis d’une prolongation, interroge sur sa proportionnalité au but poursuivi. Aucun avantage financier ou de gestion n'est démontré du côté des caisses, tandis que le préjudice économique pour le salarié peut être significatif.
Le Conseil d'État ou le juge judiciaire pourraient être saisis sur ce point au titre du contrôle de la légalité des circulaires et instructions internes, voire au nom du principe d’égalité devant la loi sociale.
La réforme du 1er septembre 2024 marque une inflexion nette dans l'interprétation du droit à indemnisation maladie. En imposant une lecture strictement formelle de la continuité des arrêts de travail, elle crée un espace de vulnérabilité entre prescription médicale et couverture effective. Cette désynchronisation, en réintroduisant de facto des périodes sans indemnité, remet en question l'effectivité du principe de protection sociale.
À l'heure où le législateur renforce le suivi des arrêts et lutte contre la fraude, il serait nécessaire de concilier rigueur administrative et respect des droits fondamentaux des assurés. Une clarification doctrinale, voire un encadrement législatif, semble inévitable pour restaurer la cohérence du régime.
LE BOUARD AVOCATS
4 place Hoche,
78000, Versailles
https://www.lebouard-avocats.fr/
https://www.avocats-lebouard.fr/
https://www.lebouardavocats.com/